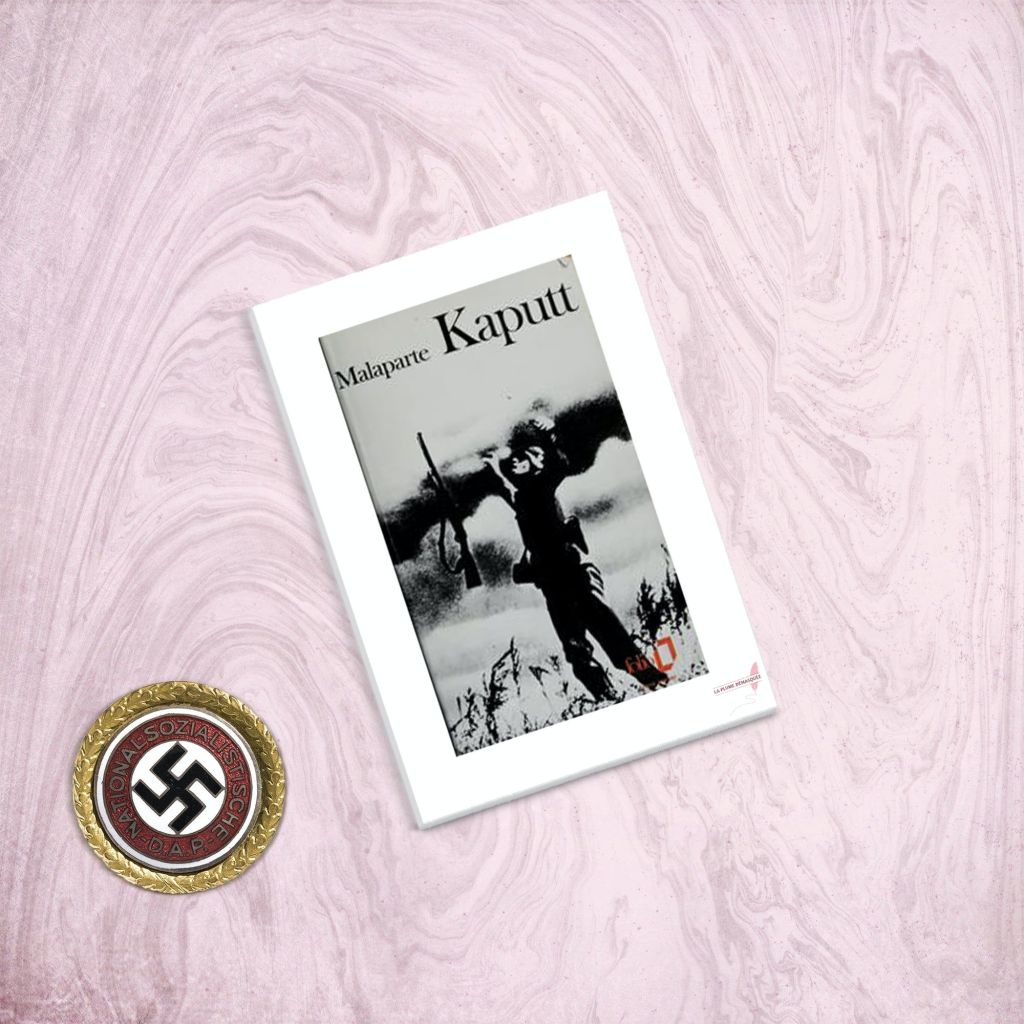J’avais adoré le matriarcat de Blackwater, je me suis replongée avec délices dans l’univers de cet auteur dépoussiéré par les éditions Monsieur Toussaint Louverture avec les splendides couvertures de Pedro Oyarbide.
On sent la patte du cinéaste dans la scène d’introduction qui nous trimballe dans le New York de la fin du 19eme siècle. La famille Stallworth, aisée, sûre de ses prérogatives, manigance pour l’ascension sociale. La famille Shanks manigance pour vivre. Léna la noire, a la vengeance chevillée au corps. Quand le juge Stallworth s’attaque à son domaine, on sait qu’une seule des deux familles sortira son épingle du jeu. Ou son aiguille d’or. Addictif et brutal, on s’attache aux personnages de cette saga en un tome qui se déroule sur une année. La crasse côtoie les robes à crinoline et les tripots mal famés les églises et les clubs féminins aseptisés. Du très bon Mc Dowell.