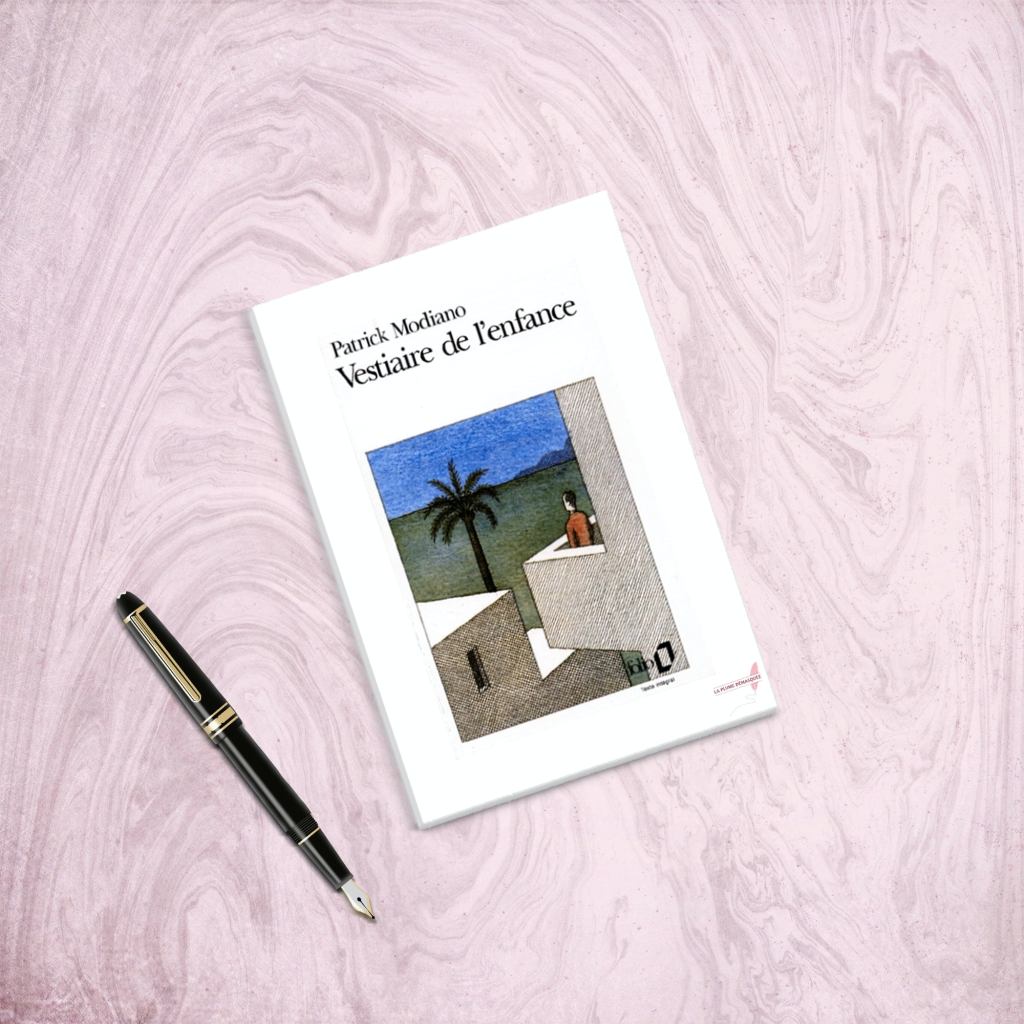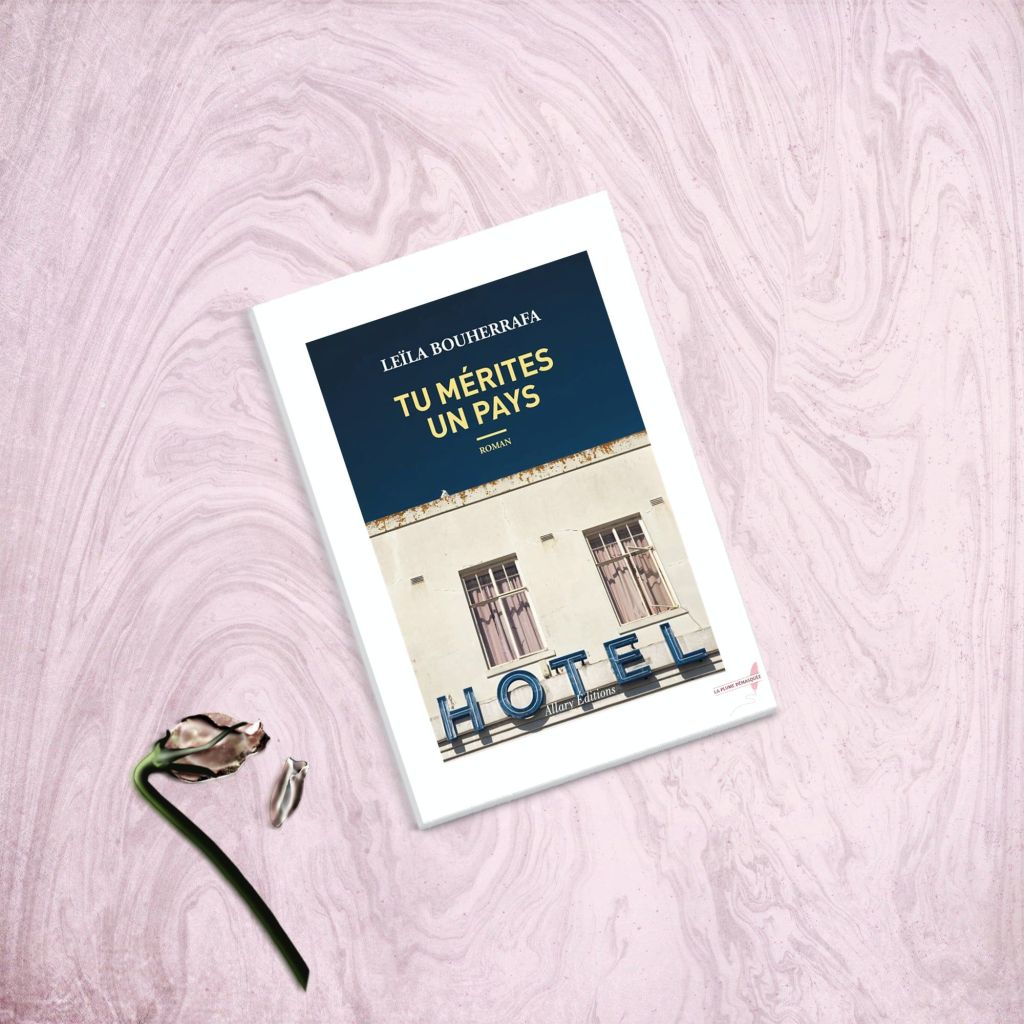Lire Mathias Enard est toujours une expérience. Cet écrivain d’une érudition qui dépasse celle du commun des mortels de loin, imagine toujours des histoires où les scientifiques sont spécialistes de sujets pointus. J’adore son écriture qui se lit aussi bien qu’elle est aiguisée, elle aussi. Pour autant, ce roman m’a laissée perplexe dans sa construction. Deux histoires parallèles se déroulent d’un chapitre à l’autre sans jamais se rencontrer. Tout du long, on imagine qu’on va comprendre ce qui les rassemble, personnellement, je n’ai pas trouvé la clé de ce rapprochement. Mon avis est qu’il n’y en a pas. On croise donc d’une part cette historienne des mathématiques, fille d’un éminent mathématicien disparu tragiquement, fidèle au régime communiste de l’Allemagne de l’Est jusqu’à la chute du mur et même au-delà, qui raconte une croisière conférence organisée en hommage à son père qui doit démarrer le 11 septembre 2001 et qui s’arrête donc, à peine amorcée, sa mère, sublime, qui a vécu à Berlin ouest, femme politique de renom, et d’autre part, ce déserteur dans une région méditerranéenne qui rencontre une femme fuyant la guerre avec son âne. Une expérience à part entière, dans un style impeccable, c’est le plus fidèle résumé que je puisse faire.