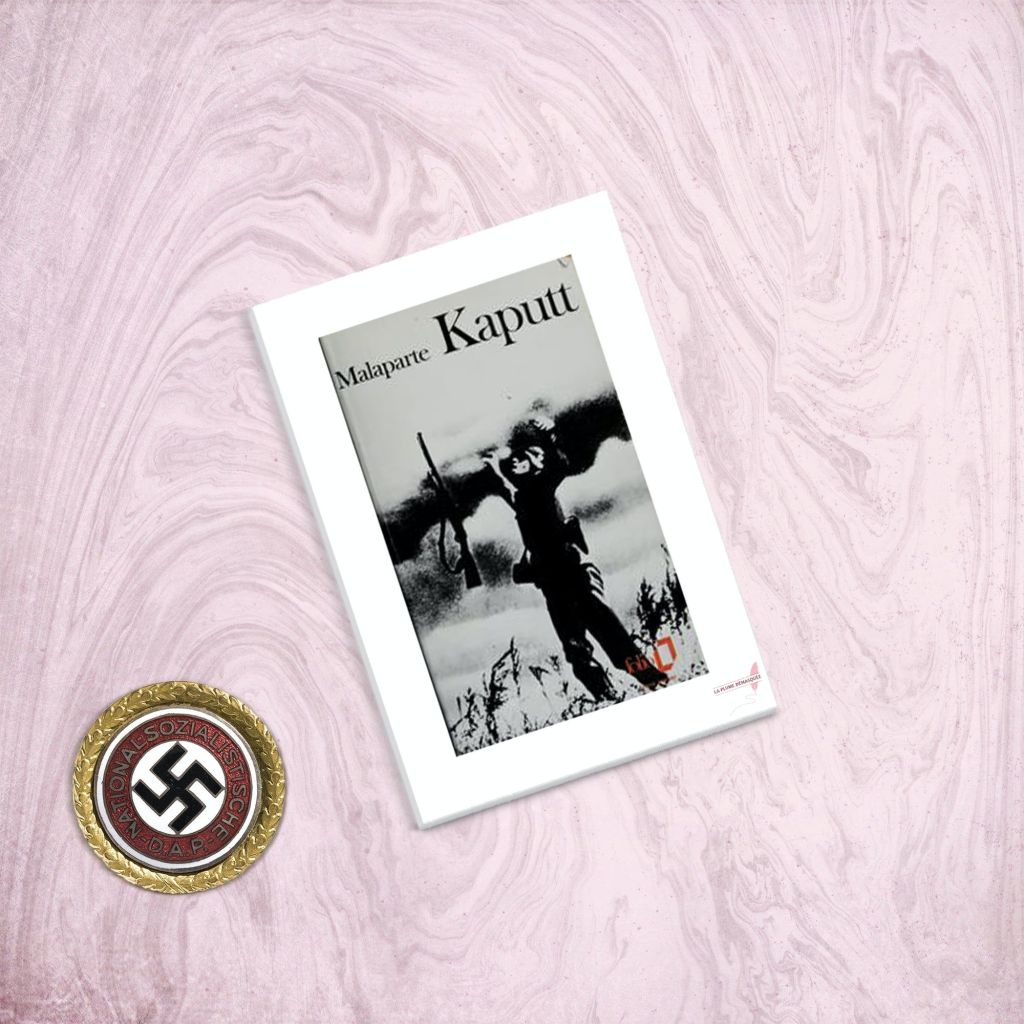Ce classique italien, dont le manuscrit lui-même est chargé d’histoire puisque ce récit a été écrit pendant la deuxième guerre mondiale entre 1941 et 1943, sur l’horreur de la guerre, son absurdité et la folie des hommes pendant cette même période. Il a été divisé en trois parties, caché, et chaque partie a rejoint son propriétaire pour qu’il soit finalement publié en 1944.
La conséquence du parcours chaotique de ce manuscrit est peut-être la raison d’une écriture hachée dans le temps qui a amené l’auteur à réutiliser les mêmes images poétiques tout au long du récit en répétitions un peu lassantes. Chaque histoire terrible fait reposer le livre un moment tant il est lourd de l’horreur qu’il décrit. Massacres divers, pogroms, domination, c’est un roman ironique et cynique sur l’impuissance, comme le disait l’auteur : un livre horriblement cruel et gai.
En effet, les six parties qui parlent d’animaux (Les chevaux, les rats, les chiens, les oiseaux, les rennes et les mouches) mettent en miroir le sacrifice des animaux pendant une guerre orchestrée par les hommes où les anecdotes sont racontées dans dîners mondains aussi absurdes que l’aberration de la guerre elle-même.
Il note l’ironie du mot « Kaputt » en allemand, une certaine fatalité de ce qui est brisé, alors que son étymologie vient d’un mot hébreu « Kopparoth » qui fait référence à la victime sacrifiée.
Je suis contente d’être allée au bout, mais il pèse comme un cheval mort. Dans ces périodes troublées, il est néanmoins essentiel de retourner aux sources des contemporains de cette période effroyable.